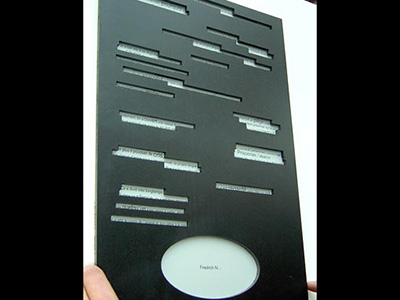« Nous avions l’habitude de travailler à deux dans la salle des machines. Chaque matin, c’était toujours la même dispute pour s’avoir qui aurait le droit de choisir la station de radio qui nous accompagnerait dans notre travail. Ça voulait dire que l’autre n’allait rien comprendre pendant toute la journée. Pour nous départager, nous avons fini par trouver un petit jeu : on laissait tomber des objets, n’importe lesquels, dans une cuve remplie d’eau ; celui qui la faisait déborder avait perdu. Un matin, je n’avais plus d’objet sous la main, alors j’ai ouvert une des caisses de l’exposition. J’y ai trouvé des sortes de peintures très fines. J’en ai déposé quelques unes dans la cuve ; elles se sont immédiatement décomposées dans l’eau en une multitude de couleurs, mais sans jamais faire monter le niveau. Grâce au grand nombre de peintures stockées dans la caisse, j’ai gagné pendant plus d’un mois.
Et pourtant, quand j’y repense, cette radio n’était pas si importante que cela. Celle qui comptait le plus, c’était l’autre ; celle que j’allumais ma cabine dès que je partais travailler en salle des machines. Je la laissais seule toute la journée. Je voulais qu’une présence occupe dans ma cabine. Le soir, quand je rentrais dormir, je la coupais pour mieux sentir ce qui s’était dit pendant mon absence. »
|


« Un jour, un albatros est tombé sur le pont. Il s’est mis à pousser des cris déchirants. On ne savait pas très bien pourquoi il criait comme cela. On lui a donné à manger. Mais il criait toujours. L’un d’entre nous disait qu’il reconnaissait dans ces cris des sons de sa propre langue. En faisant bien attention, chacun d’entre nous pouvait y retrouver des sons de sa langue. On s’est mis à se disputer pour savoir de quelle langue il était le plus proche, chacun voulant que ce fut la sienne. Sans doute exaspéré par nos cris, l’albatros a cherché à s’enfuir. Mais on ne voulait pas. On voulait l’entendre encore et encore. On a cherché un piège pour le maintenir prisonnier sur le pont. On a cherché partout. Finalement, on a ouvert une caisse de l’exposition et on a trouvé une sorte de sculpture qui convenait parfaitement comme cage. Prisonnier, l’albatros poussait des cris de plus en plus déchirants ; et plus il poussait de cris, plus chacun d’entre nous y reconnaissait sa propre langue.
Puis il a fini par mourir. On s’est regardé sans dire un mot. Ça a duré très longtemps. Et dans ce silence, on s’est tous retrouvé.
Puis quelqu’un s’est remis à parler, alors on a jeté le corps de l’animal et son piège à la mer. »
|


« Dès le début j’ai été attiré par une caisse de l’exposition. Chaque jour je restais un petit moment à côté sans savoir vraiment ce qui me retenait à elle. Puis un jour où l’air était particulièrement humide, j’ai compris. Le bois dont était fait cette caisse provenait de mon pays. Je le reconnaissais parfaitement à l’odeur de la sève qui suintait encore des planches. Je me suis souvenu des forêts où je passais des journées entières à me promener. Au cœur de cette forêt, il y avait un arbre creux dans lequel j’avais pris l’habitude d’enfoncer la tête pour y dire tous mes secrets.
Ça m’a pris d’un coup. Je n’ai pas réfléchi. J’ai ouvert la caisse, et je l’ai vidée ; j’ai tout jeté par dessus bord. Je me suis enfermé dans la caisse pour y dire tout ce que j’avais à dire. Ça a duré des heures.
J’étais tellement attaché à cette caisse que quand les autres m’y ont retrouvé, ils ont dû prendre des couteaux pour décoller la semelle de mes chaussures qui s'étaient engluées dans la résine. »
|


« Le jour où nous avons appris que notre cargaison allait enfin arriver à bon port, nous avons tous sautés de joie. Cinq ans de traversée, loin de chez soi, c’était suffisant. Nous étions tellement heureux, que nous nous sommes tous mis à chanter. On dansait sur les caisses de l’exposition. Mais nous ne connaissions aucune chanson commune ; chacun chantait dans sa langue. Malgré nos chants, on pouvait entendre les objets tomber et se fracasser à l’intérieur des caisses. C’étaient des bruits sourds, presque réguliers. Ils ont donné le rythme. Et même si on chantait des chansons différentes, on a commencé à le faire dans le même tempo. On a fini par se sentir tous réunis.
Quand tous les objets ont été réduits en miette à l’intérieur, et qu’ils ne produisaient plus le moindre son, on a ouvert les caisses. On a voulu recoller les morceaux pour recommencer à chanter. Mais on ne savait pas à quoi ressemblaient les objets qu’on avait détruits. Chacun avait bien sa petite idée. Mais ce n’était pas la même. Alors quelqu’un a dessiné ce qu’il avait en tête, et les autres l’on suivi. À la fin du voyage, on s’est échangé nos dessins. »
|